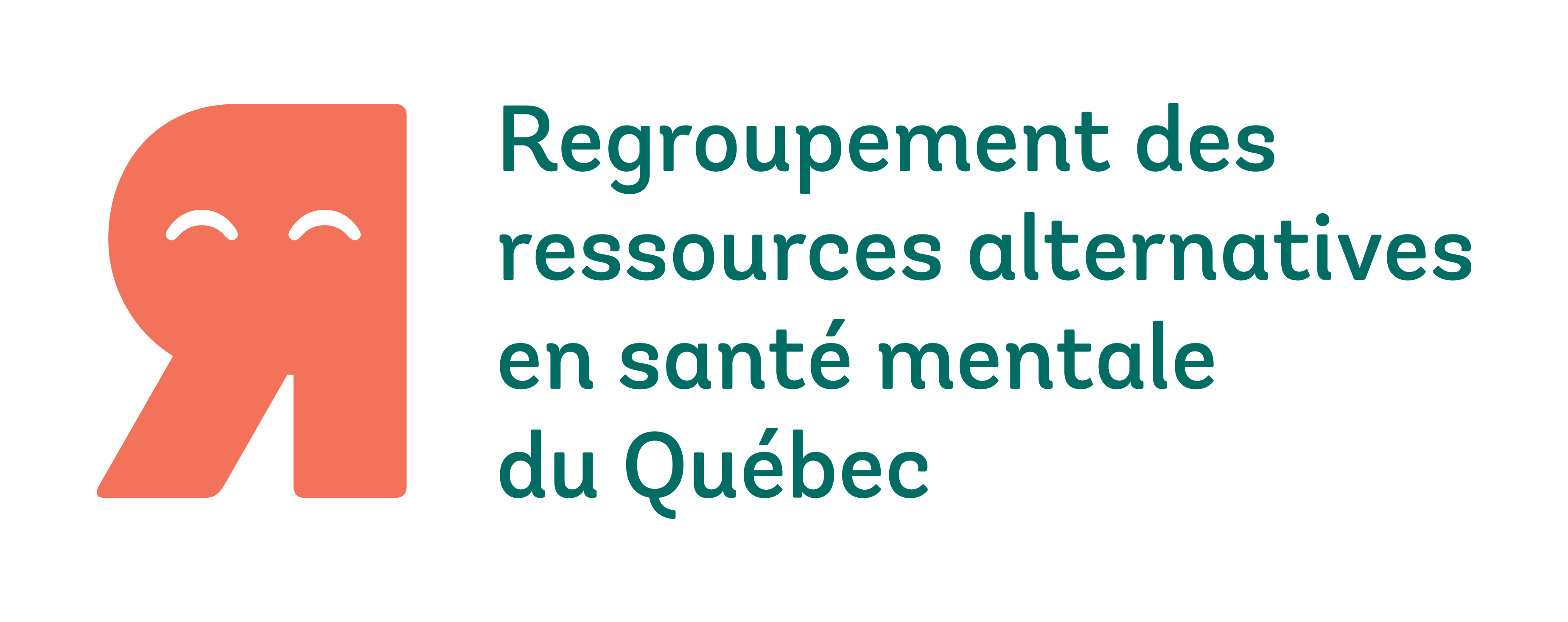Plus de 40 ans d'alternatives solidaires en santé mentale!
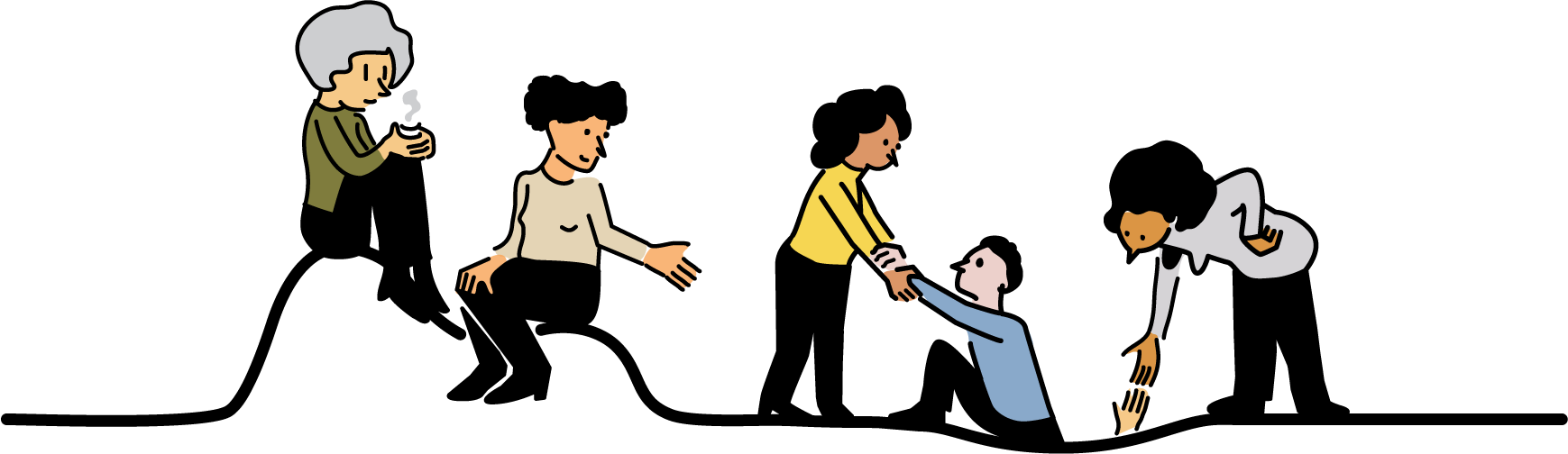
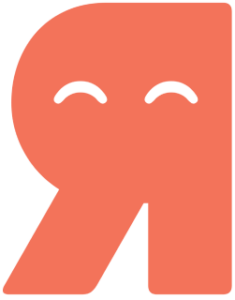
Bienvenue sur le site du RRASMQ!
On y trouve des informations sur nos activités et outils, les coordonnées des ressources alternatives partout au Québec et bien plus. Bonne visite!
Rechercher une ressource

La Gestion autonome de la médication est une démarche qui s’appuie sur une vision globale de la personne et de son mieux-être dans une perspective d’appropriation du pouvoir et d'amélioration de la qualité de vie.